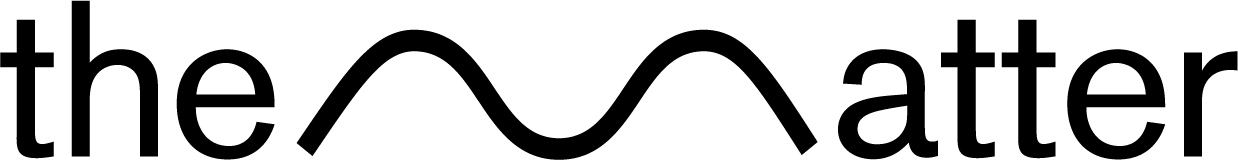Hwendo Na Bu a
Festival Kimpa Vita – Édition spéciale Bénin
19 & 20 novembre 2022
Village des Arts, Dakar, Grand Yoff
Pour cette prochaine édition, theMatter s’associe à la Kimpavita pour vous proposer une exposition d’arts visuels béninois mêlant costumes traditionnels et photographies contemporaines de Laeïla Adjovi et Léonce Raphaël Agbodjélou. L’ensemble des œuvres, présenté dans un espace inédit du Village des Arts, s’ancre dans l’univers spirituel du Bénin et tente d’en révéler certains rituels.
Dans le cadre de cette édition de l’évènement Kimpavita, consacrée au Bénin, theMatter propose une exposition d’art visuel béninois « Hwendo Na Bu a »
(préserver la culture, la tradition) mêlant costumes traditionnels Egungun à des photographies extraites des séries de Laeïla Adjovi (Les Chemins de Yemoja) et de Léonce Raphaël Agbodjélou (Egungun Masquerades).
Ces séries sont toutes deux inscrites dans le témoignage et la préservation de la spiritualité vodou. L’une ancrée essentiellement sur le territoire fon et yoruba autour de Porto-Novo, l’autre dépassant les frontières originelles pour s’intéresser, faisant suite aux migrations de l’esclavage, aux disséminations, ramifications et mutations de cette culture sur la rive américaine de l’Atlantique.
Ces recherches et travaux photographiques, complémentaires, proposent une approche historique et documentaire, dans le but de présenter les croyances, les rituels, les cultes des spiritualités vodun, tout en accumulant des traces, des témoignages, du matériel pour la préservation de cette religion et plus largement, de ce patrimoine.
Deux costumes Egungun sont exposés, « désactivés » de leur esprit par les prêtres lors d’une cérémonie appropriée pour les transformer en objet de représentation, et permettent aux visiteurs d’appréhender au plus près et en taille réelle ces majestueuses créations.
theMatter, créé en 2017, dont les œuvres et objets exposés font partie de sa collection, perpétue sa volonté de convoquer le sensible dans des mondes hybrides et insoupçonnés, de proposer un voyage au cœur d’un ensemble qui fait lien, à la frontière du visible et au-delà.
Les Chemins de Yemoja
Par Laeïla Adjovi
Les Chemins de Yemoja est un projet transdisciplinaire sur la migration de spiritualités ouest-africaines d’une rive à l’autre de l’Atlantique. ‘Yemoja’ vient des mots yoruba “Yeye-Omo-eja” – “la mère dont les enfants sont des poissons”. Yemoja est un orisha associée à l’océan, l’abondance et la maternité. Chez les Fon, voisins des Yoruba, chez qui les divinités sont appelées vodun, Yemoja est apparentée à Mamiwata, Mami-Sika, Agbe ou Aflekete.
Ces déités ont traversé l’Atlantique avec les millions de femmes et d’hommes déporté.e.s vers les Amériques lors de la grande Traite. Ainsi Yemoja prend les noms de Yemaya ou Aflekete à Cuba. Ma recherche photographique, documentaire et artistique aborde les processus de résistance culturelle, de résilience et de créolisation, tout en célèbrant les héritages spirituels yoruba (Nigéria) et ewe-fon (Bénin) à Cuba. Dans un monde affecté par le racisme et le repli identitaire, ces travaux mettent en lumière les relations invisibles entre des portions éparses de l’humanité, et les possibilités infinies de l’hybridation culturelle.
Les photographies argentiques ramenées du Bénin, du Nigéria et de Cuba sont mises en dialogue dans des triptyques. Mon approche visuelle, en lumière naturelle, privilégie le clair obscur, pour restituer l’une des croyances cardinales de la spiritualité des orisha-vodun : l’omniprésence d’un monde invisible qui nous enveloppe. Un monde peuplé d’ancêtres qui nous guident et nous soutiennent, à rebours de la vision judéo-chrétienne de ténèbres menaçantes, repaires du Malin.
Associée à des textes et à de la cartographie, cette galerie de portraits, de scènes de vie et d’objets de culte scelle le lien qui unit les adeptes par-delà l’océan. Car tous les visages de Yemaya-Yemoja-Mamiwata-Aflekete expriment la même idée – celle d’un trait d’union africain entre tous les lieux où elles sont célébrées.
Je suis devenue une meilleure photographe quand ‘cueillir le jour’ a pris un nouveau sens. Cueillir la lumière. Récolter des photons comme on ramasse des fleurs. Et avant cela, comme pour une fleur, l’admirer, la surveiller éclore, être à l’affût de chacun de ses mouvements, quand elle ondule et danse. S’émerveiller de la manière dont elle fait et défait les formes et les couleurs.
En marchant dans Les Chemins de Yemoja, je voulais enjamber la dichotomie lumière-blancheur-pureté contre obscurité-noirceur-péché. Habituer l’œil à une sombreur sans menace. Feutrée, ouatée, onctueuse. Rassurante comme la vie avant le monde. Enveloppante comme l’intérieur d’un ventre. Choyer l’ombre, partout où elle existe, la fixer sur le papier, y tremper quelques mots, et inventer de nouvelles formes de photosynthèse.
Ferveur transatlantique
Triptyque photographique
Série Les Chemins de Yemoja ( 2018- …) @Laeïla Adjovi
Kanho Letonde Awanzunde et Agbessi Seton sont toutes deux vodunsi ( adeptes du vodun). Elles sont sœurs et initiées, l’une au vodun Aflekete, l’autre au vodun Agbe. Face à face devant leur temple comme si un miroir les séparait, elles reflètent le lien entre les pratiquants des religions traditionnelles africaines des deux cotés de l‘Atlantique. Ouidah, Bénin © Laeïla Adjovi


Fille de Yemaya Mayelewo depuis plus de 30 ans, Regla Maria Fernandez Madan a une pratique religieuse ancrée dans la tradition Arara, transmise par les descendants d’Africains arrachés à la région de l’ancien Danxomè. Il y a plusieurs générations, l’eau a jailli dans le sol de sa maison familiale. Tous les ans, les dévots viennent faire des offrandes à cette source considérée comme sacrée. Agramonte, Cuba © Laeïla Adjovi
Egungun Masquerades
Photographie de Léonce Raphaël Agbodjelou
Dans la culture Yoruba, que l’on retrouve au Nigeria, au Togo et au Bénin, toute cérémonie mortuaire s’accompagne de la présence d’un Egungun, une matérialisation physique et honorifique de l’esprit du défunt ou celle de la divinité́ reliant les morts aux vivants.
L’aso, terme Yoruba pour désigner le vêtement, est formé du préfixe a relié au terme so qui signifie « enterrer » ou « régénérer ». On comprend donc l’importance du vêtement dans la culture Yoruba. Avec l’Egungun, le costume devient alors le point de contact entre l’esprit des ancêtres et la source de vie (ase). Cette concrétisation sublime d’une forme d’immortalité́ marque à la fois l’absence d’un être mais également la présence des ancêtres et des esprits.
Cette série photographique, que l’on peut aisément lire comme une suite de portrait, s’intéresse essentiellement aux costumes Egungun du Bénin.
À travers elle, Léonce Raphaël Agbodjelou fige des entités se mouvant habituellement lors de danses rituelles lors desquelles des couches de tissus, de sequins, de broderies, de cauris et d’amulettes tournoient en envolées spirituelles, formant un tout unificateur dans une fusion frénétique et kaléidoscopiques de matières et des couleurs.
Même statiques, ces portraits parviennent à témoigner de l’incroyable énergie qui se dégagent de ces figures lorsqu’elles sont animées. De plus, l’artiste choisit des fonds bruts, secs, délabrés, décrépits afin de les contraster drastiquement avec l’opulence et la vitalité des costumes Egungun.
Enfin, cette série Egungun Masquerades que Léonce Raphaël Agbodjelou entame en 2012, se situe à la croisée d’une recherche artistique, anthropologique et documentaire. Elle semble inscrire ces costumes traditionnels dans l’éternité par une démarche archiviste tant elle témoigne de la diversité et de la richesse de ces incarnations.
Un travail de mémoire pour un patrimoine unique, à la manière de J.D ‘Okhai Ojeikere qui a recensé photographiquement les coiffures des femmes nigérianes. Ce travail rejoint également la grande tradition du portrait africain à l’instar de Mama Casset, Malick Sidibé ou encore Seydou Keita.
* D’après Portraits of ‘the deathlessness of cloth’ de Ruth Simbao